🧠 La culture professionnelle peut-elle être en cause dans le burn-out ?
Au-delà de l'organisation du travail et de la perte de sens : comment l’environnement professionnel façonne aussi les croyances profondes qui contribuent au burn-out
Le burn-out, on en entend beaucoup parler aujourd’hui. On pense souvent que c’est le résultat de traits de personnalité : trop perfectionniste, trop exigeant avec soi-même, trop sensible… Et pourtant, de nombreuses recherches montrent que l’environnement professionnel joue un rôle central.
Cet article propose d’aller un peu plus loin : si le travail peut nous épuiser par sa charge et ses contraintes, pourrait-il aussi influencer en profondeur nos croyances et nos manières de fonctionner ? Peut-être que certaines habitudes, certaines règles tacites ou certains messages implicites transmis par notre culture professionnelle façonnent nos attentes envers nous-mêmes… et participent au risque de burn-out.
Je vous propose de partir de ce constat, de regarder ce que la science et mon expérience professionnelle peuvent nous apprendre, et d’explorer quelques pistes pour élargir notre regard sur la prévention du burn-out.
Introduction
Le burn-out est maintenant bien connu, mais encore souvent vu pour le grand public comme le résultat de caractéristiques personnelles : perfectionnisme, auto-exigence, fragilité émotionnelle… Ce d’autant que les organisations tendent à culpabiliser les individus pour ce qu’ils ne parviennent pas à réaliser comme travail. Les personnes croient donc souvent elles-mêmes être cause du problème…
Les recherches en psychologie du travail et en ergonomie ont permis de comprendre depuis de nombreuses années que l’organisation du travail est en grande partie en cause dans les risques psychosociaux. Et si effectivement, derrière chaque burn-out, on retrouve toujours des facteurs liés au travail lui-même, on retrouve aussi des croyances profondes individuelles, qui ont facilité la chute dans le piège du travail pour la personne.
Ces derniers aspects sont souvent occultés, dans les interventions de prévention des risques psycho-sociaux, sans doute principalement parce que nous n’avons pas accès à la modification des croyances des personnes, et ce n’est donc pas un objet utile pour l’intervention. Cela relève également de la sphère personnelle, qui n’a pas lieu d’être concernée à ce moment, et relève de la libre demande et envie de la personne de travailler ou sur ces aspects. Enfin, ces sujets sont tellement individualisés à l’accès, qu’il ne paraît pas forcément utile de ramener ce sujet sur le devant de la scène, au risque de voir revenir en force l’hypothèse individuelle, croyance qui reste fortement enracinée.
Ce sujet a donc été assez peu investigué.
Mais, ma propre expérience m’a amenée à questionner cette idée. Peut-être y a-t’il réellement une part individuelle, mais … et si elle-même était également influencée par le travail, à un niveau plus profond ? Et si la souffrance au travail découlait parfois de la culture professionnelle elle-même ? Et comment nos croyances individuelles peuvent-elles être façonnées ou amplifiées par l’environnement dans lequel nous évoluons ?
Entre autres, si le travail était responsable “au carré” : à la fois dans les conditions de travail tangibles, mesurables, et dans les croyances qui nous poussent à continuer alors que nous devrions dire stop ? Cela pourrait ouvrir différentes pistes de réflexion, pour peut-être mieux prévenir le burn-out, en intégrant dans les interventions un niveau supplémentaire d’action possible.
Cette réflexion s’appuie à la fois sur la recherche en psychologie du travail, en ergonomie, et sur mon expérience personnelle, en tant qu’étudiante en médecine confrontée à un système extrêmement exigeant et peu soutenant, puis en tant qu’indépendante, constatant que même sans système organisationnel de travail autour de soi, le stress et le burn-out au travail des indépendants reste possible.
1. Le rôle central du travail dans le burn-out
Le burn-out a été initialement décrit dans les années 70, même s’il n’a pas intégré la culture courante avant les années 2000. Il était initialement plutôt perçu comme une problématique individuelle, comme toute pathologie, finalement.
Christina Maslach en a formalisé le concept avec le Maslach Burnout Inventory (MBI), en trois dimensions : épuisement émotionnel, dépersonnalisation/cynisme, et sentiment de faible accomplissement personnel (Maslach, 1976, et Maslach et Jackson, 1981).
La recherche en psychologie du travail et en ergonomie a mis en évidence depuis les années 80 que le burn-out était fortement lié aux déterminants organisationnels : surcharge de travail, manque de contrôle, ambiguïté des rôles, soutien insuffisant, conflits de valeurs, pression temporelle (Karasek, 1979, Maslach & Leiter, 2008; Siegrist, 1996). Ces modèles ont été validés et nous servent aujourd’hui de base de travail en intervention sur les risques psycho-sociaux.
2. Mais des croyances individuelles augmentant la vulnérabilité aux conditions de travail inappropriées
Des facteurs intrapersonnels semblent jouer un rôle important, parallèlement aux facteurs organisationnels, augmentant la vulnérabilité à l’épuisement professionnel, tels que les croyances personnelles et les mécanismes d’adaptation (Bamber et McMahon, 2008 ; Simionato et Simpson, 2018, Simpson et al, 2019).
Ces facteurs souvent décrits comme des schémas précoces inadaptés ou des croyances conditionnelles et inconditionnelles (Beck, 2011). Ces schémas, tels que « je dois toujours réussir », « je ne peux pas montrer de faiblesse », ou « mon travail définit ma valeur », augmentent la vulnérabilité au stress.
Par exemple chez les professionnels de la santé mentale, Ledingham (2015) a retrouvé une tendance à minimiser sa propre vulnérabilité, inhiber les émotions perçues comme un signe de faiblesse, s’efforcer d’atteindre des normes de résultats plus levées en niant leurs besoins.
Ces schémas précoces inadaptés ont une tendance à nous faire répéter des comportements qui ne nous rendent pas service, et sont liés classiquement à des besoins non satisfaits durant l’enfance. Ils sont le résultat de ce que nous avons retenu des messages implicites intériorisés tout au long de l’enfance et de l’adolescence.
En l’occurrence, ils empêchent les professionnels concernés de sortir du cercle vicieux de toujours plus de travail pour faire mieux, plus vite… qui finit par les épuiser, dans un contexte où faire bien peut déjà être complexe.
3. Et si la culture professionnelle impactait nos croyances et attitudes personnelles ?
Ce questionnement me vient de plusieurs constats.
Mon expérience personnelle illustre cette dynamique :
Étudiante en médecine pendant 9 ans, j’ai été confrontée à un système extrêmement exigeant et peu soutenant. La culture hospitalière valorisait l’efficacité maximale, normalisait la fatigue et le manque de sommeil, et interprétait toute erreur ou signe de fatigue comme une faiblesse personnelle. Il fallait toujours aller vite, être performant et ne jamais montrer ses difficultés. Ce cadre m’a façonnée à adopter une culture de performance permanente, qui n’existait pas avant mes études et est plutôt difficile à déloger.
Quand j’ai commencé à intervenir comme psychologue du travail et ergonome, j’ai pu constater à quel point les causes organisationnelles du stress étaient centrales, et j’ai régulièrement observé ces mécanismes dans différentes entreprises et contextes professionnels. Cependant, j’ai été surprise de voir que même des indépendants, qui théoriquement contrôlent entièrement leurs conditions de travail, pouvaient être exposés à un stress important et à des troubles musculo-squelettiques. Si le stress dépendait uniquement de l’organisation du travail, comment expliquer que ces professionnels puissent se retrouver dans les mêmes situations d’épuisement que des salariés, alors qu’ils ont la possibilité de structurer leur travail librement ?
En fréquentant de nombreux réseaux professionnels d’indépendants, il est apparu clairement que le stress et le burn-out étaient fréquents, et que la culture entrepreneuriale jouait un rôle important. Dans ce milieu, l’effort et le travail acharné sont valorisés, et l’image de l’entrepreneur débordé est souvent considérée comme la norme : « si tu n’es pas débordé, tu ne travailles pas assez ». Très peu de dispositifs de prévention sensibilisent les indépendants au risque de sur-travail et d’épuisement. De plus, commencer à travailler à un rythme intense peut ancrer durablement cette culture : elle peut ensuite se répercuter lorsque l’entreprise se développe et mettre en difficulté les futurs salariés.
Ces observations me conduisent à pense que la culture professionnelle peut influencer nos croyances et attitudes, au-delà des conditions objectives de travail. Si l’environnement professionnel valorise la surcharge, la disponibilité constante et la perfection, cela peut contribuer à intérioriser des croyances limitantes : « je dois tout réussir pour être légitime », « mon travail définit ma valeur ».
Il n’existe apparemment pas de recherches établissant un lien direct entre environnement professionnel et croyances profondes qui augmentent le risque de burn-out, mais cette hypothèse mériterait d’être explorée.
La théorie des assumptive worlds de Janoff-Bulman (1992) montre que les individus s’appuient sur des croyances fondamentales — le monde est bienveillant, juste, et soi-même a de la valeur. Lorsqu’un traumatisme survient, ces croyances peuvent être brisées, générant une souffrance psychologique. A la suite de ces travaux, on pourrait émettre l’hypothèse que des micro-traumatismes répétés au travail — remarques dévalorisantes, mise en avant systématique des échecs, absence de reconnaissance, valorisation de la surcharge — puissent avoir un effet analogue, conduisant à intérioriser des croyances contraignantes comme « la seule façon d’être légitime dans ce métier est d’être parfait ».
4. Pistes de réflexion
A partir de cette réflexion, je pense qu’il serait intéressant, en intervention, d’élargir le cadre de travail : l’environnement professionnel ne se contente pas de générer du stress par la charge ou les contraintes, il peut sans doute aussi laisser une empreinte sur les croyances et attitudes de chacun. Les messages implicites de l’organisation – valorisation du surengagement, de la perfection, de la disponibilité constante – façonnent des règles internes que les individus s’imposent ensuite à eux-mêmes (et qui restent… tout comme les TMS ne s’arrêtent pas le soir venu en partant de l’entreprise).
Adopter une lecture systémique de ce phénomène consisterait à recadrer (au sens systémique de Palo Alto) l’organisation elle-même : quels signaux l’entreprise transmet-elle à travers ses pratiques managériales et la structuration du travail ? Quelles normes tacites les équipes intègrent-elles et comment contribuent-elles à l’auto-exigence excessive ou au perfectionnisme ?
En élargissant le cadre d’intervention à cette “empreinte organisationnelle”, il paraîtrait possible et intéressant d’agir non seulement sur les structures et les processus, mais aussi sur la manière dont ils façonnent les croyances professionnelles, permettant de prévenir le burn-out de façon plus globale et durable.
Références (APA)
Bamber, M., & McMahon, R. (2008). Danger—early maladaptive schemas at work!: The role of early maladaptive schemas in career choice and the development of occupational stress in health workers. Clinical Psychology & Psychotherapy, 15, 96–112. https://doi.org/10.1002/cpp.564
Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.). Guilford Press.
Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. Free Press.
Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285–308. http://www.jstor.org/stable/2392498
Ledingham, M. (2015). Beliefs and perceptions about burnout amongst mental health professionals (Doctoral dissertation). Retrieved from http://ro.ecu.edu.au/theses/1684
Maslach, C. (1976). Burned-out. Human Behavior, 5, 16–22.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2, 99–113.
Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1(1), 27–41. https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.1.27
Simionato, G., & Simpson, S. (2018). Personal risk factors associated with burnout among psychotherapists: A systematic review of the literature. Journal of Clinical Psychology, 1–26. https://doi.org/10.1002/jclp.22615
Simpson, S., Simionato, G., Smout, M., et al. (2019). Burnout amongst clinical and counselling psychologists: The role of early maladaptive schemas and coping modes as vulnerability factors. Clinical Psychology & Psychotherapy, 26, 35–46. https://doi.org/10.1002/cpp.2328



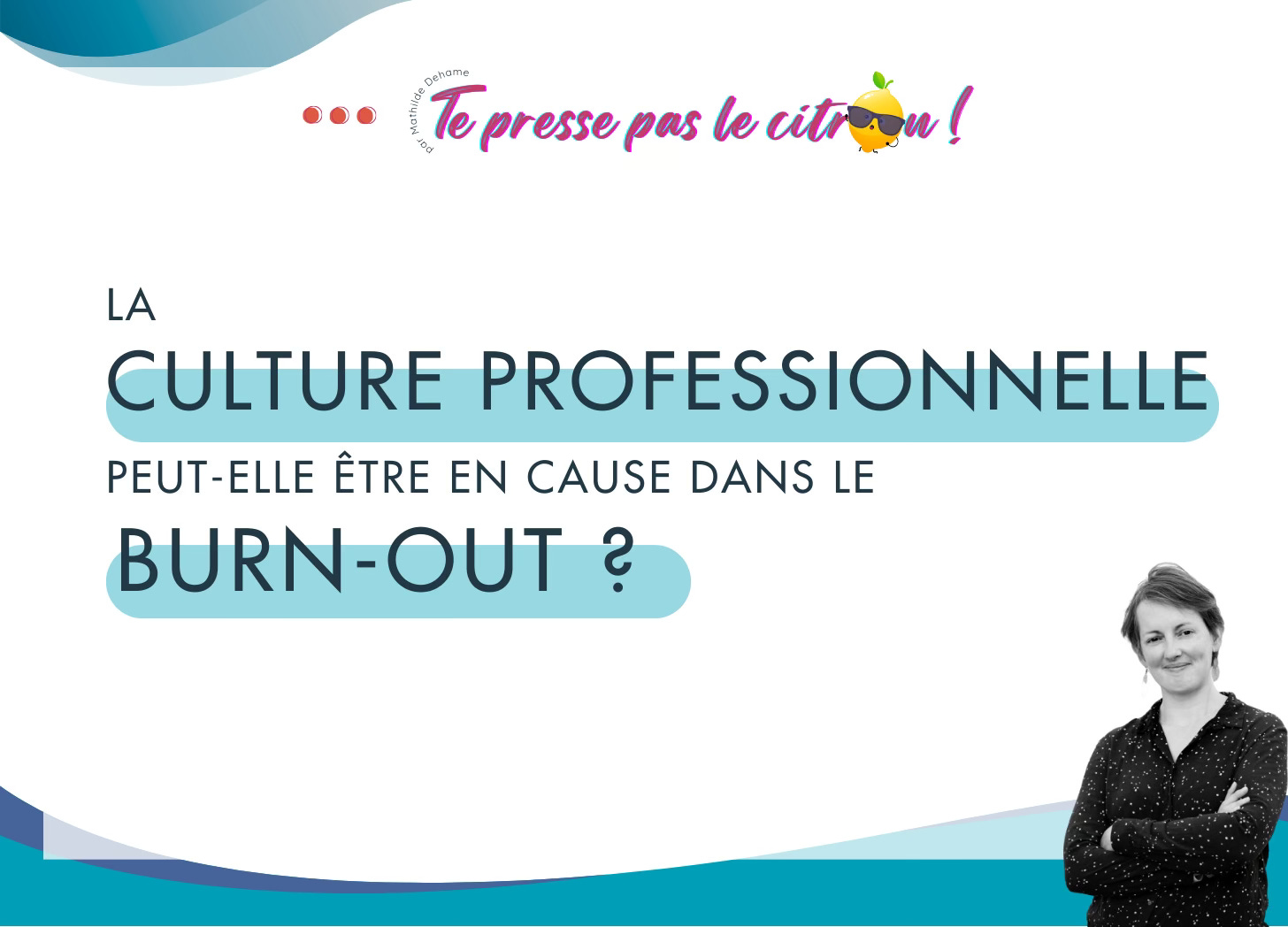
C'est passionnant. Merci pour cette analyse. Ayant vécu un burnout je me retrouve dans beaucoup de points. Je pense que la societe dans son ensemble tend à faire porter la responsabilité sur les individus pour se dédouaner. On le voit dans les domaines de l'alimentation, temps passé sur les réseaux, santé mentale... Si c'est la faute de l'individu alors la société (gouvernement) n'est pas responsable donc zero dépense !